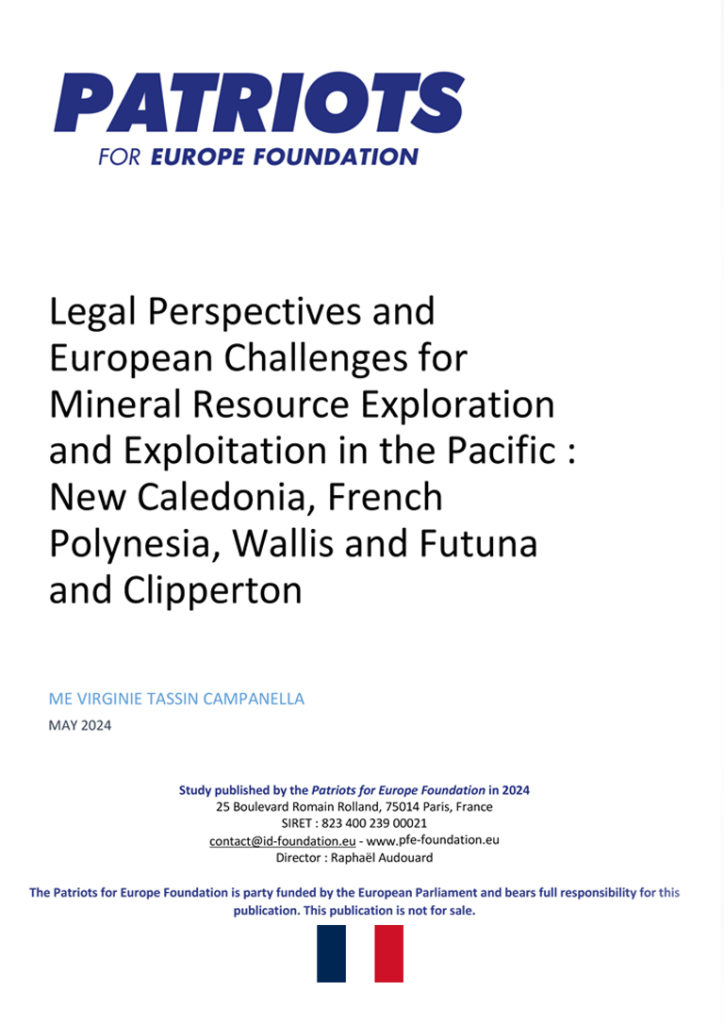Rapport fonds marins dans le pacifique
Perspectives juridiques et enjeux européens concernant l’exploration et l’exploitation des ressources minérales dans le Pacifique : Nouvelle- Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Clipperton
Le plateau continental est un espace comprenant le sol et le sous-sol des fonds marins proches des côtes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a suscité l’intérêt des États en raison de la richesse de ses ressources, essentielles aux efforts de reconstruction de la société d’après guerre.
Son régime juridique, tout à fait unique en droit international, fut façonné de manière à consacrer un droit exclusif et privilégié de l’État côtier lui permettant d’accéder, de bénéficier et de protéger les ressources naturelles (principalement hydrocarbures et ressources minérales) des fonds marins proches de ses côtes. C’est ainsi que le concept de « droits souverains » fut créé. Il n’est ni tout à fait l’expression d’une souveraineté, puisqu’elle est limitée aux activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, ni tout à fait l’expression d’un simple droit exclusif, puisqu’il intègre la dimension du monopole de l’État à travers le concept de « souveraineté ». La Convention de Genève sur le plateau continental de 1958, qui fut le premier cadre international intégrant le régime du plateau continental, ne fut cependant que peu mise en œuvre en raison de contestations relatives à la définition géographique du plateau continental.
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) opéra quant à elle, sur la base d’une négociation inédite associant pays développés et pays nouvellement indépendants, une redéfinition géographique de cet espace du plateau continental. Alors que les droits souverains d’exploration et d’exploitation sont préservés à l’identique, l’étendue géographique du plateau continental est considérablement prolongée, offrant le bénéfice des droits sur une distance géographique fixe à tous les États côtiers (jusqu’à 200 milles marins – et ce, quelle que soit la réalité géologique de ces fonds) et permettant aux États pouvant prouver le prolongement naturel de leur territoire terrestre sur leurs fonds marins1 d’étendre la limite externe de leur plateau jusqu’à une limite maximale d’environ 350 milles marins.
En parallèle de cette extension de l’étendue géographique du plateau continental, un autre régime juridique fut créé et consacré dans le cadre de la CNUDM : celui de la zone économique exclusive (« ZEE »). Souvent plus connu que le plateau continental – voire confondu avec lui –, ce régime, principalement tourné vers la consécration de droits exclusifs et privilégiés de l’État côtier sur ses ressources biologiques, a la particularité de se superposer géographiquement à celui du plateau continental. À cette superposition géographique s’ajoute une superposition des droits souverains de l’État côtier. En effet, l’État côtier a dans le cadre de la ZEE des droits souverains étendus, incluant l’exploration et l’exploitation des ressources non biologiques (donc de la même manière que ceux consacrés dans le cadre du régime du plateau continental) et biologiques, mais aussi des droits souverains de conservation et de gestion des ressources biologiques et non biologiques. Il en résulte dès lors un « doublon » qui, dans le cas d’une autorité unique de gestion (l’État côtier), ne pose aucune difficulté. Or, dans le cas d’une répartition des compétences entre l’État côtier (en l’occurrence la France) et un territoire d’outre-mer, cette répartition peut s’avérer complexe à mettre en œuvre, surtout lorsque des considérations externes à cette mise en œuvre s’invitent, notamment l’articulation entre le droit coutumier local et le droit français.
Une étude de la répartition des compétences entre l’État français et quatre territoires situés dans l’océan Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Clipperton) révèle la grande hétérogénéité des statuts juridiques et du mode de répartition des compétences. Certaines similarités peuvent néanmoins être explicitées :
i) L’État français, dans les quatre territoires étudiés, n’a pas transféré ses droits souverains sur le plateau continental. Il a par ailleurs réalisé pour trois de ces territoires des demandes d’extension de ce plateau.
ii) Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française : l’État français a transféré au bénéfice de ces territoires les droits souverains de la ZEE, réalisant de ce fait une « cohabitation » de droits dans l’espace des 200 milles marins entre, d’une part, l’État français (plateau continental) et, d’autre part, le territoire concerné (Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française concernant la ZEE).
iii) Dans le cas de Wallis-et-Futuna et Clipperton, malgré un statut juridique différent, l’État a conservé dans ces territoires la souveraineté, le contrôle et la juridiction complète sur son espace marin.
En sus de cette répartition géographique des compétences, une répartition a par ailleurs été opérée par domaines. De manière générale, l’État français reste compétent dans tous les domaines régaliens, ce qui implique que des instruments applicables aux domaines de la défense, de la police et de la sécurité (hommes et infrastructures) pourront s’appliquer aussi dans l’espace géographique de compétences des territoires.
D’un point de vue de développement des activités, la superposition géographique des compétences entre la ZEE et le plateau continental – dans le cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française– entraîne nécessairement une limitation réciproque dans l’exercice des droits souverains. À ce titre, et concernant de manière plus précise l’exercice des droits souverains d’exploration et d’exploitation sur le plateau continental, un moratoire d’exploitation des ressources minérales dans la ZEE a été institué par la Polynésie française. Un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des mêmes ressources dans la ZEE est en cours d’examen en Nouvelle-Calédonie, et un autre est en cours d’élaboration à Wallis-et-Futuna.
Il en résulte une situation tout à fait inédite. En raison de ces mesures de gestion et de protection des ressources prises au sein des 200 milles marins, l’État français ne sera pas en mesure d’exercer ses droits souverains d’exploration et d’exploitation dans ce même espace sans violer les droits souverains de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française (concernant Wallis-et-Futuna, ce projet de moratoire reflète un conflit de souveraineté sur les fonds marins). Par contre, l’État français rencontrera moins de contraintes dans le cadre de son plateau continental étendu, les contraintes restant cependant présentes, compte tenu du niveau de protection élevé des espaces marins et de la biodiversité, et du manque de connaissances relatives aux ressources et aux écosystèmes.
Étude réalisée par Me Virginie Tassin Campanella
Étude publiée par la Fondation Patriotes pour l’Europe