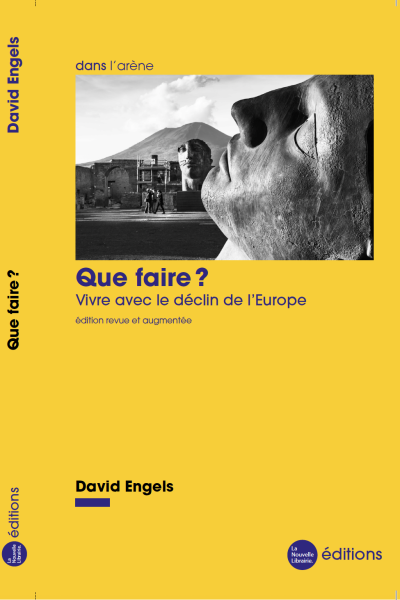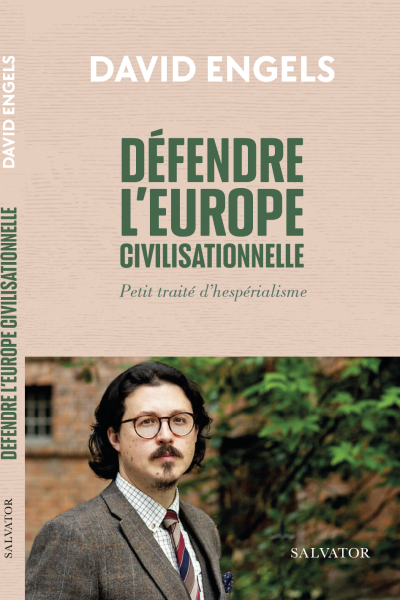Dans Le Déclin et Que faire ? Vivre avec le déclin de l’Europe, l’historien belge David Engels développe une lecture radicale de la crise européenne. Ce n’est pas seulement l’Union Européenne qui est en crise, mais la civilisation elle-même : les nations sont effacées, les mémoires historiques oubliées, les racines chrétiennes délaissées. Contre ce processus de dépersonnalisation, David Engels plaide pour un sursaut culturel, local et spirituel fondé sur les identités nationales qui composent l’Europe.
Une crise de civilisation aux racines profondes
Dans Le Déclin, David Engels propose un parallèle saisissant entre la chute de la République romaine et la trajectoire actuelle de l’Europe. Il observe une centralisation croissante du pouvoir entre les mains de technocrates bruxellois, au détriment des États membres, réduits à des exécutants. La crise grecque a marqué, selon lui, un tournant : un pays souverain mis sous tutelle financière, dans l’indifférence générale.
Mais cette perte d’autonomie politique ne serait qu’un symptôme d’un mal plus profond : un effondrement civilisationnel.
David Engels évoque une Europe qui a perdu son âme, sa cohérence, sa conscience historique. Loin de toute nostalgie figée, il considère que la désagrégation de l’Europe vient du rejet de ses fondements : l’héritage gréco-romain, les racines chrétiennes, les traditions nationales qui ont forgé ses peuples.
« L’Europe a perdu sa capacité à maintenir des institutions cohérentes au service de ses peuples », écrit-il.
« Les États sont devenus des coquilles vides, où le pouvoir effectif est désormais détenu par une oligarchie économique. » David Engels décrit un continent désarmé, fragmenté, soumis à des forces globales et désincarnées.

Une mémoire commune au prix de l’effacement des nations
Cette aliénation s’exprime, selon Engels, dans la tentative des institutions européennes de construire une mémoire collective « neutre » ou « universelle », en rupture avec les récits nationaux. Un exemple emblématique l’illustre en 2024 : le Parlement européen a adopté une résolution portée par la députée allemande Sabine Verheyen (PPE), visant à promouvoir une « conscience historique européenne ». Ce texte appelle à la création de manuels d’histoire transfrontaliers pour « faire tomber les barrières nationales ».
Ce projet s’inscrit dans une démarche assumée de réécriture du passé commun à des fins d’unification idéologique. Comme le souligne une tribune publiée dans Valeurs actuelles en février 2024, cette volonté de standardisation de la mémoire s’apparente à une entreprise révisionniste, où l’histoire devient un outil politique au service de la construction européenne. Les auteurs de la tribune évoquent l’existence d’un « projet orwellien », accusant l’Union européenne de vouloir imposer un récit unique au mépris des identités collectives des peuples européens.
Pour David Engels, c’est exactement le cœur du problème : « On ne construit pas une identité en choisissant uniquement quelques pensées aussi universelles qu’impersonnelles. » Cette identité européenne imposée d’en haut est, selon lui, une fiction désincarnée. « Si l’Europe n’a pas la volonté radicale d’assumer l’histoire et la tradition et de les projeter dans l’avenir, alors l’expression même d’Union européenne sera perçue par ses citoyens comme une coquille vide. »
Résister par la culture, l’histoire et la transmission
Face à ce constat, Engels ne préconise ni révolution politique, ni restauration autoritaire, mais une forme de résistance enracinée et personnelle. Dans Que faire ?, il appelle à recréer des communautés locales capables de préserver, transmettre et faire vivre les traditions nationales et l’héritage culturel européen. Il évoque une stratégie de long terme : soutenir l’agriculture locale, restaurer des solidarités de proximité, sortir des grandes métropoles mondialisées, fonder des écoles libres et alternatives.
« Il ne s’agit pas de réformer l’État, mais de construire un modèle social alternatif au sein de communautés soudées, qui échappent au contrôle de l’État et de ses institutions dominantes », écrit-il. Engels propose un engagement concret, discret mais déterminant : « La résistance constructive ne passe pas par l’opposition systématique aux institutions, mais par la création de réseaux de solidarité dans la vie quotidienne. »
Il plaide également pour un retour à une mémoire vivante, transmise, assumée : « Il ne s’agit pas de construire une nouvelle identité, mais de comprendre et assumer l’identité culturelle et historique que l’Europe porte en elle. »
Engels refuse la résignation. Il appelle les « derniers Européens » à préserver ce qui peut encore l’être, non par nostalgie, mais par fidélité à une civilisation dont l’effacement n’est pas une fatalité — si ses héritiers prennent conscience de ce qui est en jeu.